LA COMMUNAUTE ITALO-TUNISIENNE
A TRAVERS DEUX OEUVRES LITTERAIRES
LA RIVA LONTANA de Marinette PENDOLA-MIGLIORE
et
à FLANC DE BOU-KORNINE de Rosaire di STEFANO
________
Dans ce colloque sur les communautés méditerranéennes, nous nous posons spontanément la question sur l’identité et la situation de ces entités ethniques et sur leurs rapports avec la Tunisie, terre méditerranéenne d’asile, d’immigration et d’émigration.
Les communautés méditerranéennes en Tunisie sont d’origines multiples. Celle qui nous intéresse dans notre analyse est la communauté italo-tunisienne en Tunisie dans la période qui se situe des années quarante jusqu’à nos jours cela veut dire la génération des immigrés siciliens nés entre les deux guerres mondiales. Si le mot «communautés italo-tunisiennes » était au pluriel c’est parce qu’il se baserait sur le choix de communauté sicilienne de classes sociales différentes : une rurale et l’autre citadine appartenant à deux catégories sociales : le colon terrien et l’ouvrier journalier.
Cette communauté sicilienne en Tunisie ne pouvant répondre pour des raisons historiques et géographiques aux critères que Renan donne pour la nation, serait plutôt dans les caractéristiques d’une nation ethnique en tant que communauté linguistique comme le propose Guy Héraud. Il écrit : « il n’y a que la langue qui peut être une vraie composante de nation. On désigne aujourd’hui de ce terme la mentalité, la sensibilité, l’approche du monde et des êtres et tous les autres traits de caractère qui définissent le comportement moyen d’un peuple, sa «personnalité de base » [1] .
Cette personnalité de base qui caractérise l’identité d’un peuple serait-elle présente dans la communauté italo-tunisienne que je vais présenter dans ma communication ? Son sens de l’altérité et par conséquent des autres communautés qui ont vécu en Tunisie serait-il différent ? Assimilation et acculturation ou rejet de l’Autre ?
Dominique Vincentelli, n’a-t-il pas écrit que «sans un fort sentiment d’appartenance à un groupe, l’individu perd son identité et son autonomie. Il ne se dissout pas dans le groupe, mais peut y affirmer son individualité » ? [2]
C’est cette problématique que nous poserons au cours de notre intervention à travers deux œuvres littéraires : La riva lontana de Marinette Pendola-Migliore et A flanc de Bou-Kornine de Rosaire di Stefano. [3]
Nous essaierons de percer les similitudes et les différences entre les deux auteurs par rapport aux événements et aux lieux de Tunisie. Quel apport thématique nouveau recevons-nous par rapport aux recherches sur les communautés méditerranéennes au Maghreb et en particulier en Tunisie ? Ce colloque nous permettrait peut-être de sortir du chemin de la répétition des banalités inoffensives marquées du sceau de la sagesse commune ? Car ici, nous parlerons aussi de ce «drame de la conscience des italo-tunisiens » en Tunisie et hors d’elle pendant la deuxième guerre mondiale, pendant la lutte des Tunisiens pour l’indépendance et au lendemain des accords d’Evian (1962) où comme l’affirment Youssef Courbage et Philippe Fargues :
les pieds noirs gagnèrent quasiment toute la France. Dans la fougue patriotique, on appela «rapatriés » ces familles nées outre-mer, et pour plus de la moitié d’un ancêtre débarqué d’Espagne ou d’Italie. A la veille du double choc que furent les indépendances et la création d’Israël, deux millions de non-musulmans, chrétiens d’origine européenne et juifs des temps immémoriaux, vivaient au Maghreb. Cette présence qui a été vouée à l’éternité, a virtuellement disparu. Les 100.000 qui habitent maintenant le Maghreb ne sont plus, sauf cas d’espèce, les reliques de l’ancienne colonie, mais des étrangers, pour la plupart des immigrés, dont le statut ne diffère en rien, à la connivence près, de celui de n’importe quel ressortissant étranger. [4]
Dès les premières pages de son livre, DI Stefano écrit :
mon chez moi, c’est nulle part, mes racines ont été suspendues. Elles ont été détachées de leur humus, la Tunisie était «la terre nourricière ». (p.2)
Au mot «rapatriement », il substitue le substantif «expulsion ». « Je vivais dans un espace social varié : il a éclaté » (p.14) ; « j’ai une identité. N’être africain que depuis quatre générations, cela veut dire aussi être né, avoir été élevé en Afrique et avoir été nourri de diverses cultures qui m’ont déterminé à jamais. Je me sens en tout cas plus africain que ces jeunes maghrébins de la 2e génération nés en France qui revendiquent, aussi naïvement que j’ai pu le faire pour l’Afrique, la reconnaissance d’une appartenance à une culture locale. (Certains ont l’accent marseillais ou parisien et moi je garde une pointe d’accent arabe. Tout naturellement, je préfère le mien ». (p. 16)
Nous sommes au cœur du problème. Avec la simplicité de son vocabulaire, Rosaire di Stefano nous fait plonger dans le problème de chaque communauté maghrébine transplantée en France et en Italie par rapport à la fixation d’une identité. Ils sont devenus des «rapatriés » remodelés et rééduqués. Nous avons mis des guillemets pour le mot rapatrié car son ambiguïté est elle-même un sujet de discussion.
A ce sujet, nos deux auteurs ont écrit des pages entières pour exprimer cette angoisse de ne pas appartenir au pays d’exil qu’ils ne connaissaient pas avant leur départ forcé. « Aucun livre en classe n’a su décrire pour nous une nuit d’été africaine. Personne n’a pu faire vivre un couscous en train de se faire dès le matin... ou encore «sentir » une mloukhia mijotante depuis la veille... nous aurions pu mieux voir nos rangées de palmiers au bord de la mer avec un soleil qui se lève pour de bon. Ou bien les kilos d’or fondu et gorgé de lumière, enveloppant et soudant entre elles des piles de makrouds et de zlebias » (pp.22-21), écrit di Stefano. Marinette Pendola-Migliore se surprenait (pp.17-18) à penser à ce pays où elle devrait aller vivre, un pays dont elle ne savait rien même si on lui disait que c’était le sien et dont elle ne se rappelait que quelques photographies de villes et d’hommes politiques dans son livre d’histoire. C’était tout ce que représentait pour elle l’Italie.
Commençons par présenter nos deux auteurs. L’écriture de la vie romancée de Marinette Pendola Migliore et Rosaire di Stefano s’est faite plusieurs années après leur départ. Le roman biographique de Marinette Pendola est édité chez Sellerio (Italie). Les deux auteurs ont eu le besoin d’écrire pour exorciser leurs souvenirs. Des souvenirs qui remontent aux années quarante et cinquante. Les années qui sont à la veille de l’indépendance tunisienne, sont marquées par la présence d’Italiens de la deuxième ou troisième génération et par conséquent se sentant aussi tunisiens que tous les autres par la même terre, les mêmes traditions, la même école, les mêmes faits historiques et économiques et surtout la même rue fréquentée par les enfants. A cela s’ajoute un fait primordial qui les lie tous les deux : c’est la couche sociale qui a eu peur de rester après l’indépendance car il y a eu la confiscation des terres et des biens immobiliers.
Marinette Pendola est née à Tunis le 16 août 1948 de parents tous les deux d’origine sicilienne, mais nés en Tunisie. Elle a fréquenté l’école primaire du village de Draa-Ben-Jouder où elle habitait et puis l’internat mixte de Zaghouan jusqu’en juin 1961. En 1962, elle est partie définitivement pour l’Italie avec sa famille. Elle a été dans le camp de réfugiés de Alatri dans la province de Frosinone. Elle ne connaissait pas la langue italienne. Après son transfert à Bologne, elle vivra une vie normale (maîtrise universitaire, mariage en 1972, une fille Francesca née en 1975 et le Doctorat en troisième cycle avec Paris X Nanterre sur une thèse : Mlle Aissi ou l’invention d’un mythe). Elle finit d’écrire son roman La riva lontana en 1998.
Marinette Pendola appartient à une famille qui avait sa terre du côté du Pont du Fahs à Draa-Ben-Jouder et puis à Oued El Khadra du côté de Zaghouan. Ce sont des agriculteurs. Leur vie est marquée par une vie agricole et saine. Seulement à travers le flash back intégral de la vie d’une petite à jeune fille et dont la «cornice » est le jour du départ, nous percevons cette contradiction des sentiments : l’angoisse d’appartenir à deux pays : un que l’auteur connaît bien mais qu’elle doit laisser et l’autre qu’elle doit retrouver et qui est inconnu mais qui se présente comme un retour aux origines. Ces racines multiples d’une enfance heureuse qui a vécu sur l’ambiguïté des faits rendant plus sensibles les réactions, les émotions et la volonté d’adaptation.
Son histoire est à compartiments : les souvenirs surgissent au fur et à mesure qu’elle revoit les lieux et les personnes le jour du grand départ : c’est le mécanisme des associations d’idées. Le temps du récit est le présent comme si l’auteur écrivait au moment de son départ : la force de la mémoire et l’importance du vécu revêtent et expriment ici cette déchirure du départ : le sentiment de déracinement, de mort et de perte totale de sensations physiques. Ce sont les émotions profondes du chavirement que sent un être qui perd son appartenance à un lieu, aux choses qui ont caractérisé les lieux les plus intimes de son enfance :
Beaucoup sont partis pour l’Europe et ceux qui sont restés n’avaient pas l’âme pour aucune fête. Les pensées étaient consacrées aux parents lointains…Je ne me suis pas résignée à passer un lundi de Pâques sans reprendre contact avec les pierres antiques, comme si d’elles puisse émaner une énergie qui inonde chaque cellule en moi jusqu’à la saturer, comme si ma vitalité devait être réanimée par le souffle imperceptible du vent qui murmure entre les broderies de marbre ou par le toucher délicat et amoureux des âmes pensives, tristes de ma souffrance inconsciente. J’ai insisté, l’année dernière, pour qu’on m’amène à Thuburbo Majus. Mais chacun répondait à ma demande des réponses fragiles, de celles qui sont légères comme les aigrettes transparentes qui couvrent les membres doucement en les révélant…Une visite d’adieu. Nous descendîmes de la voiture… Je voulais au contraire m’enfermer en moi-même très étroitement, recueillir toutes les impressions, toutes les odeurs, tous les fragments de paysage que j’aurais pu porter dans ma poitrine trop petite pour les contenir tous. La terre s’est obscurcie, les marbres délavés avaient assumé une pâleur lunaire, le silence rythmé par les rafales de vent donnait à la ville une identité nouvelle dans laquelle même pas les âmes, habitantes tacites des lieux, se reconnaissaient. Je ne les entendais plus vaguer autour de moi, à la recherche de je ne sais quelle consolation. Peut-être se cachaient-elles en attente de voir surgir des nouveaux mondes. Peut-être quelques anciens fils se sont coupés en moi et je me retrouvais orpheline inconsciente de l’âme même du monde, dont la respiration avait jusque-là perçu avec un tel naturel insouciant. Je pressais le pas vers mon oncle, Thuburbo Majus ne m’intéressait plus. [5]
Cette même émotion se retrouve chez Rosaire di Stefano dans son «recueil de souvenirs » de 324 pages ! : A flanc de Bou-Kornine [6]
Pour nos deux auteurs, Pendola et di Stefano, les adjectifs et les verbes expriment la douleur et la mort lente. Le départ, pour tous les deux, a été senti comme une maladie, une perte d’identité qui a créé en chacun d’eux le sentiment de la solitude.
di Stefano fait partie de la classe ouvrière sicilienne la plus défavorisée. Il est fils de maçon journalier et sans moyens. Lui-même s’est arrêté au certificat d’études primaires car aller étudier à l’école secondaire à Tunis était pour ses parents une dépense qu’ils ne pouvaient absolument pas se permettre. Survivre était leur lot quotidien. C’est ainsi que di Stefano s’est vu ballotté entre le chômage et les petits travaux irréguliers de maçonnerie. Puis il sera recruté par un cabinet de comptabilité après avoir étudié quelques notions de comptabilité en autodidacte. En 1958, il sera champion de Tunisie de cyclisme sous le nom de Pascal di Stefano *. A Paris, en 1963, il se retrouvera de la même manière avec sa famille. Quelques années après, il se mariera avec une française et aura deux enfants. Il habitera Senlis dans l’Oise. En 1983, il fera un retour éclair à Hammam-Lif dans le cadre d’un voyage touristique pour Hammamet. Son livre sera l’expression mémorisante de sa vie en Tunisie à travers ses retrouvailles avec la ville de Hammam-Lif.
Deux écrits et deux langues : Rosaire DI Stefano écrit en langue française car c’est la seule langue véhiculaire qui lui permette de s’exprimer adéquatement. L’autre écrit de Marinette Pendola-Migliore est dans la langue italienne. C’est un choix et non pas la seule langue véhiculaire qu’elle possède. Nous avons, ici, une différence de niveau d’écriture et d’expression du point de vue de la qualité narrative, celle d’un ouvrier avec un professeur universitaire.
Ce sont deux livres qui exorcisent la souffrance et la douleur de «rapatriés » malgré eux après tant d’années. Cet exorcisme se fait par la méthode du «flash back » d’une focalisation interne de l’écriture : le je écrivant le texte et s’écrivant dans le texte. Ce "je" autobiographique fixe la mémoire en faisant survivre les souvenirs les plus chers qui risquent de se perdre s’ils ne sont pas déjà perdus par la transformation totale des lieux, par la disparition des personnes et des faits qui les concernent. L’oubli serait le mot-clef de cette recherche mémorisante des faits. Cela aurait été un fait banal si ce n’était pas une période qui avait marqué nos auteurs et la Tunisie en même temps. Le «je » de l’écriture représente à la lecture d’autres livres de maghrébins un «nous » ou à la limite un «ils » collectif car c’est l’expression d’une génération marquée par les mêmes événements historiques.
C’est un vrai besoin de ressourcement qui amène nos auteurs à évoquer la vie routinière et quotidienne d’autrefois, une volonté de recherche identitaire à travers le vécu qui les pacifie et les tranquillise par rapport aux grands événements du choc du rapatriement. Ce sont des repères qui en psychanalyse permettent à leurs protagonistes de constituer une hiérarchie événementielle mais aussi une explication justificative de certains actes manqués actuels.
Guy Dugas, dans Vie et mort d’une littérature de l’immigration : la littérature italo-maltaise en Tunisie [7] , parle de cette littérature du point de vue sociologique comme «un véritable laboratoire ». Et il poursuit en écrivant : « La littérature semble constituer au moins une espèce de catharsis de la mémoire et de l’imaginaire entre «exil » et «extraneité » dans la langue de l’Autre. Un ensemble d’écrivains maghrébins adhère à l’écriture romanesque d’abord par le discours ciblé autour des réminiscences de la mémoire. Réminiscences focalisées sur l’enfance, la mère, les institutions et les lieux marqués par l’ancestralité. »
Marinette Pendola et Rosaire di Stefano font partie de la génération du déracinement, de l’exode et de l’exil. Ils expriment leur acculturation occidentale comme une identité de rapatriés.
Guy Dugas, dans la même intervention citée plus haut, remarque : « Depuis ses débuts, et encore de nos jours, la littérature maghrébine de langue française ne cesse de porter l’empreinte de son errance entre le lieu de son ensourcement identitaire inaugural et ses tensions vers l’espace autre (France/Occident) ou elle s’épanouit et/ou elle s’exile. »
Marinette Pendola, pendant des années après son départ de la Tunisie, a dû subir une psychothérapie pour comprendre et résorber une migraine qui ne voulait pas la lâcher. Son livre a été le moyen le plus efficace pour se libérer du poids d’une mémoire touchée dans son essence. Repères d’enfance et d’adolescence qui s’affrontent chaque jour. Ses racines ont pris le pas sur son déracinement ressenti immédiatement dans le camp de réfugiés en Italie. Le cas de Marinette Pendola est intéressant car contrairement à la plupart des personnages de la littérature étrangère parlant de la Tunisie, il parle du monde paysan. La terre constitue l’enracinement et l’appartenance à une communauté ethnique. Le sens du terroir d’origine (Marsois, Hammamlifois, Zaghouani, Sicilien, Napolitain... etc.) permet à chacun de se voir à travers le miroir des repères de sa terre natale.
Contrairement à Marinette Pendola, Rosaire di Stefano nous décrit tout au long de son récit, son autrefois nostalgique et en même temps il peint la situation présente de la ville de Hammam-Lif. Les deux auteurs utilisent deux descriptions narratives différentes. Pendola décrit sa vie en Tunisie à travers les flash back qui naissent au fur et à mesure de son éloignement de sa ville natale vers Tunis, lieu de départ définitif et di Stefano à travers son retour au pays. Tous les deux ont tenu à cacher au fond du tiroir de la mémoire leur vie en Tunisie à cause du blocage qui s’est fait consciemment malgré la nostalgie.
di Stefano replonge dans le bain des souvenirs dès qu’il arrive à l’Aouina où la grande émotion lui fait «gicler les larmes sur la vitre du bus. » (p.28) «toute la joie d’être était concentrée là, au pied des deux cimes majestueuses du Bou-Kornine », dit-il «entre Carthage et Korbous, il protégeait notre micro-bonheur de tous les vents de la scoumounia tel le chameau accroupi dans la tourmente protégeant le nomade aventureux. » (p.21)
A l’aide d’images et de métaphores, notre auteur avec le langage hérité de générations de migrations essaie d’exprimer la joie et la tristesse de son vécu en Tunisie. De l’avant-propos à la démarche rétrospective (p.6àp.25), il tâtonne son terrain pour aller au cœur du problème. C’est un noyau que l’auteur ne peut sortir de son fruit que s’il épluche lentement les souvenirs marquants à double tranchant. Le mouvement du livre s’accélère au fur et à mesure qu’il pénètre dans l’espace tunisien en utilisant la préposition «ici » à «chez nous ». Les visages et les lieux deviennent moins étrangers. La sensation de connu et de déjà vu s’insinue dans la mémoire de l’auteur et c’est l’explosion.
Les lieux avec les noms des rues et des villes sont très précis comme si dans leur reconstitution, nos auteurs avaient besoin de se situer à nouveau dans l’histoire pour mieux se définir. Mais pour le lecteur, ces lieux sont focalisés de façon historique. C’est le patrimoine culturel de notre pays qui surgit à nouveau pour mieux le connaître. La ville d’Hammam-Lif comme La Goulette, a été marquée par la présence de maçons siciliens. On y retrouvait le même genre de quartier «piccola Sicilia » qui caractérisait Catania ou Siracusa. La «petite Sicile » était aux abords de St Germain (Ezzahra actuellement).
Par conséquent, Rosaire di Stefano et Marinette Pendola nous font une topographie des lieux : à Hammam-Lif, le palais beylical, le café maure, les gargotes, le hammam, le palais Disca, le train qui était à vapeur puis «décoville » à mazout (p.73), le stade, Bou-Kornine avec son chalet vert et son cimetière, la plage avec son casino et sa «frégate », le café des chômeurs sous les arcades, le bain thermal, la briqueterie, le cinéma en plein air et même les deux maisons closes pour tunisiens et européens («Le palmier » et La «citeria »)** : ce sont d’autres temps et d’autres mœurs. Sur la Petite Sicile qui avait une place particulière au sein des communautés pauvres de la ville, Rosaire di Stefano raconte : « le quartier était une importante réserve ouvrière de la ville avec ses contingents d’apprentis et de maîtres maçons, de charretiers transporteurs de pierre et de sable. Puis, les garages et les ateliers ont continué à entretenir l’image de marque du Sicilien bon à tout faire de ses mains. Quelques dépôts d’huile et quelques moulins à grain. » (p.72). di Stefano réussit à faire évoquer tous les souvenirs qui peuvent concerner les Hammamlifois. Il perpétue leur mémoire en proposant dans ses anecdotes la vie quotidienne de leur ville dans les années 40 et 50.
Le livre de di Stefano est adressé à un lecteur français et par conséquent, nous avons l’impression à la lecture qu’il y a une recherche de tous les éléments positifs qui caractérisent la vie tunisienne. Notre auteur insiste beaucoup sur la tolérance qui existait avant l’indépendance. Enfance de pauvre mais riche de signes, de symboles et d’histoires comme celle relatée par son grand-père sur le cimetière arabe à flanc de Bou Kornine : « chaque tombe blanche possède un petit creux dans le ciment, suffisamment profond pour retenir une quantité d’eau de pluie. Cette eau, disait-on, est destinée à abreuver les oiseaux de passage afin que les morts soient visités en permanence par la vie et par le ciel »(p.50 di Stefano). Cet humanisme de la religion musulmane est évoqué par un catholique : la bonne connaissance de l’Autre permet l’appréciation et la tolérance. Malgré cette cohabitation, les préjugés ancestraux ne disparaissent pas. Par exemple, la communauté juive, selon di Stefano, semble ne pas avoir de nationalité. comme les Tunisiens musulmans avaient le titre d’Arabe, les juifs qu’ils soient d’origine arabe, italienne, maltaise ou française avaient toujours le titre de juifs.***
Si pour lui, écrire c’est exorciser sa souffrance, pour le lecteur c’est au contraire avoir un témoignage du passé qui, à cause des changements radicaux que la Tunisie a subi, s’est vue transformés ses rues, ses magasins, son stade, son marché et la mentalité de sa population. Un train de vie qu’il serait difficile de reconstituer s’il n’y avait pas des témoins et des historiens. L’espace devient donc une source de repère de la mémoire.
L’école française, l’école italienne Lolipao de la rue de la poste, l’école de garçons «franco-arabe » (p.37) et le palais beylical qui est devenu un hôpital. L’histoire beylicale est relatée en évoquant les musiciens de sa cour avec leur rituel de fantasia ainsi que la troupe beylicale qui joue un air de musique encore utilisé dans les fêtes de circoncision (p.43). Les fêtes, pendant le règne beylical, avaient un rythme différent : les films en plein air, la musique et les danses dans la place du palais, les feux d’artifice, les mâts de cocagne, la casse des gargoulettes, la course de bourricots, le repas de fête offert par les princes pendant la fête de l’Aîd. N’oublions pas le palais «Disca » avec sa petite coupole. Rosaire di Stefano nous apprend aussi qu’en 1930, la mer a grossi jusqu’à arriver au passage à niveau du bain thermal, entraînant les guérites de plage par le boulevard Salambo recouvrant ainsi à peu près toute la ville (p.56). Le Casino formait avec le palais beylical un axe de symétrie parfaite.
Sous la plume de di Stefano, nous sentons encore la grande concurrence et inimitié qui existe entre la capitale Tunis et Hammam-Lif : « Tunis, que l’on délaissait volontiers, était ce petit Marseille inquiétant où les cloisons devaient être aussi marquées entre les classes sociales d’une même ethnie qu’entre les ethnies elles-mêmes. Son lycée Carnot était rempli d’enfants de fonctionnaires et de bons commerçants parmi lesquels quelques boursiers à la «très bonne tête » ou paternés par une Alliance Israélite vigilante venaient se poser là comme des haricots sur une table de baccara, comme des carmélites sur la place rouge, enfin comme des cafards dans la soupe de févettes quoi... » (p.56 di Stefano). Hammam-Lif, au contraire, toujours selon l’auteur, n’avait pas de cloisons entre les différentes ethnies car cette ville a mélangé la Hara, Bab Zira et la Kasbah (quartiers juif, sicilien et arabe) dans les mêmes lieux. « Scouba politique nationale », dira-t-il. A la lecture de ces affirmations, le lecteur se pose la question s’il n’y avait pas des préjugés ancrés chez l’auteur qui semble prôner la tolérance.
Quelques noms de lieux de la campagne évoqués par Marinette Pendola qui nous situent où se sont installés les Siciliens du côté du Sahel : Aîn Jmal, Saouaf, Draa-Ben-Jouder, Enfidha, Khanget, Hergla, Kairouan, Pont du Fahs...etc.
Cette description des lieux vivants de la mémoire nous amène à parler des commerces. Rosaire di Stefano reporte dans son livre les différentes affiches publicitaires de l’époque où nous pouvons vérifier les différents métiers, les noms des familles où nous remarquons que les différentes communautés d’appartenance religieuse sont présentes. Ce sont des publicités de l’année 1947.
Sans faire une étude approfondie du phénomène, nous constatons tout de suite la fierté des Hammalifois de leur Grand Casino, des manifestations sportives et surtout l’équipe de football La Vaillante et les numéros de téléphone avec seulement quatre chiffres, l’établissement thermal qui faisait la fierté de la ville de Hammam-Lif avec ses eaux, sa montagne et sa plage, l’importance de Potinville, le zoo, le nom des rues comme Avenue Bou-Kornine, Square Wiriot, Avenue de la Gare, Avenue du Casino ; le nom des propriétaires et leur origine ethnique : D’Anna, Cantoni...**** ; les soirées dansantes des restaurants qui étaient fréquentées seulement par les «européens » comme ils étaient appelés à l’époque.
A son retour, di Stefano est déçu par un Hammam-Lif méconnaissable car cette ville est devenue un simple passage vers l’autoroute et vers d’autres destinations.
Marinette Pendola voit sa campagne partagée entre Arabes, Français et Italiens. Le mot colon ou colonisé n’existe presque pas dans son livre. C’est la guerre et le mouvement d’indépendance qui ont fait pénétrer le doute en chacun d’eux et qui a déclenché cette remise en question de la présence d’étrangers.
La 2e guerre mondiale et le fascisme ont touché cette communauté sicilienne dans ses biens et dans sa foi et l’ont divisée au sein d’une même famille. di Stefano éprouve du ressentiment et l’exprime en ces termes : « tout avait commencé quand brutalement une Italie lointaine a déclaré la guerre à une France aussi lointaine. En quelques jours, tous les hommes valides et possédant encore des «papiers » italiens, se sont retrouvés parqués comme du bétail sur des terrains vagues, sans abri et sans sanitaire, sous un soleil de plomb »(p.48).
Quant aux Italiens prisonniers des Français, notre auteur se rappelle comment sa mère a accompagné toutes ces «mammas » vêtues de noir pour approvisionner les prisonniers derrière les barbelés.
Nous apprenons aussi à travers le texte que pendant la 2e guerre mondiale «comme Rome, Hammam-Lif avait été déclaré, par les belligérants, «ville ouverte » car à défaut de Pape et de Vatican », écrit di Stefano "nous avions le Bey de Tunis dans nos murs. Nous devions en principe, bénéficier d’une certaine neutralité » (p.50). La conséquence de cet événement est la croissance de la population : de trois mille à la naissance de notre auteur à 45 mille habitants. Mais contrairement à la neutralité attendue, Hammam-Lif fut le point de mire des deux camps.
Même à la campagne, «quelques fermiers siciliens lointains même pas naturalisés, ont été massacrés sans doute pour la bonne cause pour faire activer les choses. Des manifestations de protestation ont eu lieu à Tunis » (p.50). Dans ce contexte, di Stefano évoque la figure du Président Habib Bourguiba qui a marqué la Tunisie par sa lutte pour l’indépendance : « A Tunis, Bourguiba faisait ses discours de révolution et s’efforçait de modérer les ardeurs les plus vives. Il disait de sa belle voix d’avocat : « La France est un bel artichaut qu’il faudra manger feuille par feuille. » Bourguiba savait de qui il parlait puisque c’était un de ses fils spirituels, ayant vécu et fait de longues et belles études en France. C’était donc un problème de famille dont je ne faisais pas encore partie. Mon inquiétude était qu’entre deux feuilles d’artichaut, on nous utilise, nous, comme kémia » (p.185 di Stefano).
Mais l’humour sicilien ne quitte pas di Stefano et il nous narre comment il a réagi au fascisme.
Cette Casa Italiana prétendait aussi me faire chanter les louanges d’un Mussolini énorme après une sieste interminable et, comble de culot, essayait de m’habiller en «zorro » tout noir avec un gros ceinturon mais sans masque ni fouet. Je devais dans ce déguisement répéter sans faillir et sans cesse le salut qui allait avec; un genre de bras maltais mais plus vertical, qu’il fallait envoyer très tendu au risque de me transformer en matador tellement ça me faisait cambrer... Et pour couronner le tout, je devais coiffer une espèce de ridicule chéchia même pas rouge. J’avais été sélectionné avec quelques autres chérubins pour représenter le Duce dans une cérémonie qui devait avoir lieu à la salle du théâtre au dernier étage » (p.89).
Avec Marinette Pendola, nous lisons ce cri de détresse :
Mais Alî, lui qui était assis derrière moi il y a quelques mois à l’école de Draa-Ben-Jouder, feignait de ne pas me reconnaître et me traita même en étrangère, en ennemie qu’il fallait contrôler. Après ce barrage et ce contrôle, j’ai commencé à comprendre que le monde autour de moi a changé définitivement. Et petit à petit, je me rendis à l’évidence : je suis devenue étrangère dans mon propre pays. Ce pays dans lequel je suis née, dont j’ai respiré jusqu’à l’ivresse le souffle odorant des myrtes, ce pays ne m’appartenait plus . [8]
Cette détresse, la disparition progressive des privilèges italiens et les difficultés périodiques de la question italienne ont obligé presque toute la classe ouvrière sicilienne à se naturaliser. "Curnuzia Vendutta », diront les Italiens de Tunisie. Mais le choix était du privilège des riches non ceux qui réussissaient à peine à survivre ou de ceux qui ont vu leurs biens expropriés. Louis Sitruk déclare : «Tous les Italiens nés en Tunisie de parents dont l’un y est lui-même né, mineurs au 10 juin 1940, doivent être considérés comme Français par l’application du droit commun de la nationalité Jure Soli en Tunisie. » [9]
En Tunisie, cette même nécessité de la France d’absorber les étrangers se retrouve chez di Stefano qui dit : « Le gouvernement français veut faire d’une pierre, plusieurs coups... Une génération d’artisans, de médecins, d’avocats, de fonctionnaires... etc. Ca représente des années de formation et une certaine énergie potentielle. Autant que le pays en profite. » (p.184-185). L’identité de situation commande l’identité de solution et par conséquent Louis Sitruk continue en affirmant : « Les enfants, nés en Tunisie depuis la caducité des Conventions de 1896 de parents italiens dont l’un y est lui-même né, sont définitivement français. » [10]
A partir du 9 novembre 1944, les écoles italiennes ont été expropriées pour utilité publique au profit de l’état tunisien. Nous comprenons pourquoi notre auteur a été naturalisé français. Assimilation et acculturation ont été le lot de cette communauté italo-tunisienne. A travers un fait qui semble banal en soi dans le récit de di Stefano, nous découvrons un des faits les plus marquants de cette période coloniale : dans le petit cimetière chrétien de Hammam-Lif au pied de Bou-Kornine en allant vers le Chalet Vert, les uniques Français parmi les autres communautés, sont «les Français de la C.F.T. ». Cela veut dire ceux qui ont dû se naturaliser français pour devenir fonctionnaires de la Compagnie des Chemins de Fer et avoir un emploi stable. Ce titre de naturalisé «carne venduta » était considéré péjorativement par les Siciliens. Cette expression a été utilisée surtout lorsque proches d’une même famille, se sont vus dans deux camps différents et opposés pendant la guerre et le grand départ de 1963.
Cette situation négative leur fait analyser dans une vision post-départ, les relations qui existaient entre les différentes communautés : Juifs (toutes les nationalités confondues), Arabes (tunisiens musulmans), Italiens, Français, Maltais, Grecs... etc. Ont-ils cru à une Tunisie multi-ethnique et multiconfessionnelle ?
Oui, s’ils réveillent leurs souvenirs d’enfance et d’adolescence des années quarante et cinquante. Non, s’ils évoquent le début des années 60 qui les a touchés dans leurs biens et dans leurs sentiments et qui les a obligés à tout abandonner pour regagner la France et l’Italie. Leur retour, dans les années 80 en Tunisie, leur a permis de concilier entre les deux connotations.
Chez di Stefano et Pendola, nous retrouvons cette description des spécificités communautaires même au sein d’une même «zanka » (impasse) où le musulman, le chrétien et le juif s’asseyaient chacun dans un périmètre de 1m² l’un à côté de l’autre vivant le meilleur et le pire ensemble tout en gardant chacun le respect de la pratique religieuse et des traditions dans une totale solidarité dans les moments les plus difficiles. Ne prient-ils pas le même Dieu ?
Ce cosmopolitisme permet des interférences et influences culturelles mutuelles. Les deux auteurs étudiés dans ce cadre, insistent sur cette cohabitation, sur la tolérance et sur l’amour qui la caractérisent. Prenons par exemple di Stefano, qui en parlant de la mort du grand-père qui coïncide avec l’indépendance narre cet événement :
Beaucoup d’arabes étaient là. Oui, ils étaient là ses amis de travail. Nombreux et décidés à tracer le parcours avec les autres jusqu’à l’église et jusqu’au cimetière malgré le moment, malgré la mauvaise côte que l’on prenait si on persistait à côtoyer des Roumis. C’était la période, très courte, mais active, du passage à l’indépendance du pays. Mais tout le monde a compris ce présent fait au grand-père. On n’a pas tout mélangé, grâce à Dieu et surtout grâce aux hommes. (p.120)
Et même les discussions au café exprimaient le même état d’esprit de tolérance : « Cela pouvait aller de «la cavalleria Rusticana » racontée avec chaleur par un vieux Sicilien, jusqu’à la dispersion des tribus juives dans le monde expliquée par un jeune rabbin, en passant par la signification du chandelier à sept branches, du Taleth que les copains juifs se mettaient autour du cou après l’âge de communion et auquel je n’avais pas droit, alors que mon curé, lui, en possédait un tout pareil, par l’explication du Ramadan et de son décalage au fil des ans. »(p.178) La coexistence de ces ethnies s’harmonisait à merveille parce qu’elle était ancienne et aussi parce qu’une certaine uniformisation des conditions de vie s’établissait progressivement.
Ce sens œcuménique devant les religions s’exprimait de la même manière pendant les fêtes. La nourriture, avec ses parfums bien méditerranéens, réunissait tous autour des mêmes traditions alimentaires et de l’art culinaire de leur mère. Cette communauté sicilo-tunisienne trouvait prétexte pour une continuelle cohabitation en échangeant les mets dans les plats offerts qui n’étaient jamais restitués vides mais toujours avec des recettes siciliennes. Comme «la cucia » que la mère de di Stefano, «fidèle à la tradition faisait bouillir ce blé et l’assaisonnait d’extrait de raisin cuit (vino cotto) ou de miel » (p.253) ou «lu pane Cunzato » qu’elle arrosait copieusement d’huile d’olive, les tranches fumantes, les garnissait de quelques filets d’anchois et les saupoudrait d’origan, de sel et de poivre. « C’était à se mettre en prière... ce pain garni a pu être l’ancêtre de la pizza » (p.254). « Chez Albert, les bricks étaient présentés différemment. » « Il gelato était recherché surtout pour ses granites glacés de fraise-citron. » (p.33 DI Stefano)
Chez Marinette Pendola et di Stefano, nous avons les mêmes recettes siciliennes d’olives farcies, de pâtes, de couscous sicilien à l’agneau, de salade de poulpe, d’escargots minuscules et blancs, cueillis sur les épines des champs, gorgés d’ail et de tomate, les escargots plus gros cuits avec une chakchouka pimentée, des cœurs d’artichauts crus coupés en lamelles et imbibés d’harissa et de citrons, petites boulettes de viande frites, fèves bouillies et saupoudrées de cumin, les beignets bambaloni, rougets mange-tout... etc.
L’évocation de la nourriture n’est pas gratuite car elle entoure le noyau qui est la mère nourricière. Les femmes sont le flambeau de ces histoires car ce sont elles qui réussissaient premièrement à transmettre chez les enfants la culture de leur pays en les réunissant autour d’elles. La mère comme la famille sont le leitmotiv de nos deux auteurs. C’est leur repère fondamental. La mamma italienne est le noyau autour duquel tourne la roue familiale et même tout le quartier.
Car c’est elle qui régit les rites et les traditions. Sa connaissance et son expérience lui permettent de perpétuer la mémoire de la communauté sicilienne et d’être la gardienne de l’intégrité du foyer.
Nos deux auteurs sont à la quête d’un sentiment d’amour et de stabilité qui les rassure dans leur identité plusieurs fois remise en question. N’est-elle pas la mère, symbole de la patrie? Quant l’une manque, l’autre devient défaillante.
Cette même mère a inculqué le dialecte sicilien à ses enfants. Même si nous rencontrons une infinité de mots tunisiens (recours qui expliquerait leur assimilation à la société tunisienne), le dialecte sicilien fait partie des moments émotionnels de leur écriture. Leurs mères ne parlaient pas la langue française. Dialecte sicilien au foyer et arabe avec l’entourage. C’est ainsi que nous rencontrons des mots de dialecte tunisien les plus courants.
Chez di Stefano, nous rencontrons des phrases composées de dialecte tunisien, de français et de sicilien : - « insulter «sottovoce » son cheval par madone interposée : « hak El Madonna » ; - « Andin Babour li gebek » : à chaque chicane le tunisien l’adressait à l’européen émigré. « Andin babour li gebeni » : vice-versa (p. 29 De Stefano). Les insultes peuvent fuser dans les groupes mélangés : « sale sicilien », «sale juif » et pour les tunisiens : « sale bicot ». « Andin fransa » devant l’écœurement ou la colère (p.32 di Stefano) ; « Oulid Tounsi » : l’enfant du pays qui les identifiait en France par rapport aux autres en leur répliquant « bledna ».
di Stefano, à chaque fois qu’il évoque un souvenir, voit surgir dans son esprit le mot arabe qui l’accompagne. La langue du pays s’insinue inconsciemment dans les images qui défilent pour devenir palpables dans l’écriture de la mémoire.
Les mots en arabe expriment chez di Stefano ce qu’il ne peut pas traduire dans une autre langue tel que l’italien ou le français : quelques exemples : « hassilou » : enfin, pour conclure; « chikhat » : plaisirs ; « chaklela » : problèmes, préoccupations ; « madhabia » : je veux bien ; « ya blide » : tu es lourd, méchant et débile ; « arfi » : mon patron ; « andin El Khedma » : le ras le bol du métier qu’on n’aime pas ; « khamsa wi khmiss » : le chiffre cinq contre le mauvais œil ; « tmenik » : moquerie ; « sakha » : à ta santé ; « balha » : débile ; « barcallah » : béni par Dieu ; « khitte » : che schiffo – dégoût ; « balloute » : fiction et mensonge ; « m’taa smee » : du ciel, merveilleux ; « baballah » : simple, qui accepte tout ; « inharame » : je gâche le jeu ; « miskine » : pauvre; « kahouaji » : cafetier ; « rod belek » : fais attention ; « zoufri » : déluré ; « tbikha » : perdre un match ; « khobs tabouna » : pain rond cuit traditionnellement dans un four de terre ; « farzites » : grillons ...etc.
Expressions, chansons et proverbes siciliens remplissent les pages de di Stefano qui n’a pas le niveau supérieur et culturel de Marinette Pendola.
Nous voudrions citer quelques expressions pour exemple :
« mezzo pumatto » : quand on parlait d’un tunisien à cause des chéchias rouges qui faisaient penser à des moitiés de tomates ;« disgraziato ragazzo », «chiformi » pour jouer au poker, «muletto sturdutto » : débile et étourdi, «cucuzza » : la tête, «va fatte un valso », «che rovina », «mitsika ! ...nente di meno » : devant l’étonnement, «cazzotte », «fifa » : peur, «babaloko » : débile, «a Djabanu u cozzu » : vieille expression sicilienne pour désigner l’autre versant d’une colline, dans ce cas le Bou-Kornine ; « muffa » : moisi, «mi che stanghizza » : fatigue extrême, «cazzuliare » : s’agiter et se fatiguer inutilement, «strafougnent » : se goinfrer, «che galouffa » : gourmand ; proverbes : « cucuzza è sempre cucuzza » : un débile reste un débile. (courge) ; proverbe sicilien : « ridi quannu vo’e, chianci quannu po’ » (ris quand tu veux et pleure quand tu peux). Chants de maçons siciliens : « iddu va, iddu vene, la cazzola in manu tene, ci si picchia la fantasia, la figghia mia la cazzula » (p.201).
Toutes ces expressions de dialecte sicilien oral et quotidien, nous les avons rencontrées chez di Stefano, inexistantes chez Marinette Pendola qui, par sa formation a utilisé un dialecte sicilien littéraire de haut niveau et a subi l’effet de l’acculturation par l’apprentissage de la langue française. Même dans son livre, La riva lontana, à ses yeux de petite fille, l’italien standard et la langue française étaient des signes de civilisation supérieure. Ce n’est qu’après son départ qu’elle a regretté de n’avoir pas pu apprendre à fond la langue arabe.
Cette ambiguïté linguistique est le symbole, et l’une des causes majeures de son ambiguïté culturelle. Marinette Pendola, Guido Medina, Clarice Tartuffari que j’ai présentés dans un autre article [11] comme tant d’autres auteurs de souche italo-tunisienne confirment ce que nous écrit Guy Dugas: « la majorité des italianophones étant illettrée, l’infime minorité lettrée se piquant déjà de culture française. En confirmant parmi la bourgeoisie immigrée l’usage de la langue française, l’acculturation de ces populations, encouragée par la sourdine mise aux prétentions italiennes sur cette colonie conduit après la première guerre mondiale à l’émergence d’une littérature de graphie française, venant rejoindre ce vaste courant, suscité par le colonisateur, d’une littérature nord-africaine chantant sous l’égide de la France l’union des différentes communautés en présence. » [12]
Je voudrais pour conclure poser cette question : l’homme peut-il nier son passé et l’inconscient collectif de son peuple ? Peut-il malgré l’acculturation qu’il a subie malgré lui, refouler l’identité qui lui est propre parce qu’il a immigré en Tunisie et puis émigré en France et en Italie ?
Guy Héraud répond : « non, il ne peut que refouler son passé ; un jour ou l’autre celui-ci prendra sa revanche. L’homme peut s’accoutumer à une langue nouvelle, il peut changer ses habitudes. Il ne peut transformer sa substance. Son substrat instinctif, psychique est en dehors de la portée des lois ; la volonté n’y peut rien. » [13]
Rosaire di Stefano et Marinette Pendola-Migliore n’ont fait que confirmer et révéler dans leurs œuvres cette identité déchirée.
RAWDHA ZAOUCHI-RAZGALLAH
Maître-Assistante auprès de l’Institut Supérieur des Langues de Tunis
Université 7 Novembre à Carthage
Tunis - TUNISIE
-------
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
· S. Attanasio, Parole di Sicilia : frasi, espressioni, detti, paragoni, proverbi e vastasate, Milan, Mursia, 1989, 423 p.
· E. Azzouz , L’histoire ne pardonne pas : Tunisie : 1938-1968, Paris, L’Harmattan, Tunis, Dar Ashraf Ed., 1988, 271 p.
· T. Bekri, Littérature de Tunisie in Europe 702, Montpellier, BIU/L Magasins, p.3-162.
· Gil Ben Aych, Le voyage de Mémé. Paris, Bordas, 1982.
· J. Bessis, La Méditerranée fasciste : l’Italie mussolinienne et la Tunisie, Paris, Karthala, publications de la Sorbonne, 1981, 403 p.
· H. Bourial, Les aventures de la mémoire : Quatre textes inédits : H. Haddad, Les laves bleues de Bou-Kornine; C. Fellous, Grains de lin; M. Koskas, la maksoura; René de Ceccatty : le temps qui joue, in « La Presse Littéraire » (8 mars 1999, 4e année, 3e vol., n°151).
· F. Brancati, L’emigrazione siciliana degli ultimi cento anni. Cosenza, L. Pellegrini, 1995, 344 p.
· Centre National de la Recherche Scientifique, La communauté en Méditerranée : Actes de la table ronde de Marseille, 28-30 Mai 1980 (organisée par la revue « Peuples méditerranéens » et la Recherche coopérative sur programme 502 du Centre National de la Recherche Scientifique et Technique), Paris, L’Harmattan, « Peuples Méditerranéens, 1982, 238 p.
· G. Chaliand ,C. Petit, J.P. Rageau, Atlas historique du monde méditerranéen : chrétiens, juifs et musulmans de l’Antiquité à nos jours, Paris, Payot, rivages, 1995, 88 p.
· Y. Courbage, Ph. Fargues, Chrétiens et juifs dans l’Islam Arabe et Turc. Paris, Fayard, 1992, 345 p.
· G. Crespo, Les Italiens en Algérie, 1830-1960 : Histoire et sociologie d’une migratio,. Calvisson : J. Gandmi, 1994, 182 p.
· J. Dejeux : Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française : Algérie, Maroc, Tunisie (Littérature de fiction et d’essais) (1900-1982). Paris, Karthala, 1984, 404 p.
· Ch. Haddad De Paz, Juifs et Arabes au pays de Bourguiba. Aix en Provence, Impr. P. Roubaud, 1977, 287 p.
· R. di Stefano, A flanc de Bou-Kornine, Ragusa, C.T.C, 1985. 323 p.
· M. Djegham, Le cosmopolitisme : un moment de l’histoire ? Communautés, identité (s), territoire (s), temps et usages sociaux à Tunis : 1857-1956, Saint-Martin- d’Herès – IEP, 1996, 2 vol. (205 p), (77p.).
· G. Dugas, La littérature judéo-maghrébine d’expression française entre Djéha et Cagayous, Paris, L’Harmattan, 1990, 287 p.
· G. Dugas, Vie et mort d’une littérature ; la littérature italo-maltaise en Tunisie in Littérature des immigrations (2 vol.) dir. Ch.Bonn, coll. Etudes littéraires maghrébines, L’Harmattan, 1995, vol.7/8, Fonds Robblés.
· E. Galasso, Italiens d’hier et d’aujourd’hui : l’histoire d’un peuple d’émigrants : une communauté, une culture, une tradition, Mémoire de maîtrise présenté en juin 1984, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III, 1986, 223 p.
· M. Galley & L. Ladjimi-Sebaï, L’homme méditerranéen et la mer, Actes du Troisième Congrès International d’Etudes des Cultures de la Méditerranée Occidentale (Jerba, avril 1981), Tunis, Salambö, 1985.
· G. Héraud, Les communautés linguistiques en quête d’un statut, 2e édition, Nice, Presses d’Europe, 1994.
· J. et V. Lassailly, Communautés déracinées dans les pays du Sud. Bondy, Ed. de l’Aube, 1998, 189 p. Revue “Autre Part”, numéro spécial.
· A. Lazarev, La communauté italienne en Egypte 1919/1939 : une italianité à l’épreuve des nationalismes, Paris, 1987, 245 p.
· L. Levy, La communauté juive de Livourne : le dernier des Livournais, Paris, L’Harmattan, 1996, 217 p, Collection Histoire et Perspectives Méditerranéennes.
· J. Longton, Panorama des communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Ed. Brepols, cop.1987, 262 p. Coll. Fils d’Abraham.
· Y. Katan , Oujda : une ville frontière du Maroc (1907-1956) : musulmans, juifs et chrétiens en milieu colonial, Paris, L’Harmattan, 1990, 683 p.
· A. Memmi, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur, Paris, Payot, 1973, 179 p.
· M. Pendola-Migliore, La riva lontana, Florence, Sellerio, 2000, 170 p.
· J. Perez, A. L. Udovitch , L. Valensi, Juifs en terre d’Islam : les communautés de Djerba, Paris, Edit. des Archives contemporaines, 1984, 182 p.
· R. Zaouchi-Razgallah, L’apport toscan en Tunisie, approches littéraires. in Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du protectorat, (p.131-168). Colloques Internationaux, Université Tunis I, ISHMN, Tunis, 1999, 313 p.
· L. Sitruk, La condition des Italiens en Tunisie. Tunis, Impr. du Journal « La Presse », 1947, 209 p.
· D. Vincentelli, Les régionalismes de l’Europe Méditerranéenne. Corse, Edit. Cismonte è Pumonti, 1989.
[1] G. Héraud, Les Communautés linguistiques en quête d’un statut,Nice, Presses d’Europe, 1994. p. 10.
[2] D. Vincentelli, Les régionalismes de l’Europe Méditerranéenne. Corse, Ed. Cismonte E’ Pumonti, 1989, p. 20.
[3] M. Pendola-Migliore, La Riva Lontana, Firenze, Sellerio, 2000.
R. DI Stefano, A flanc de Bou-Kornine, Ragusa, C.T.C, 1985.
[4] Y. Courbage/Ph. Fargues, Chrétiens et juifs dans l’Islam Arabe Turc, Paris, Fayard, 1997, p. 131.
[5] M. Pendola, La riva lontana, Imprimée par Litografica Mila, Bologna, 1999 ; p. 76-77 : « Molti sonopartiti per l’Europa e coloro che sono rimasti non avevano l’anima per nessuna festa. I pensieri sono rivolti ai parenti lontani…Io non mi sono rassegnata a trascorrere un lunedì di Pasqua senza riprendere contatto con le antiche pietre, come se da esse emanasse una energia che inonda ogni mia cellula fino a saturarla, come se la mia vitalità dovesse essere rianimata dal soffio impercettibile del vento che bisbiglia tra i ricami di marmo o dal tocco delicato e amorevole delle anime pensose, tristi della mia inconsapevole sofferenza. Ho insistito l’anno scorso, perché qualcuno mi portasse a Thuburbo Majus. Ma ognuno dava alla mia richiesta fragili risposte, di quelle leggere come garze trasparenti che coprono le membra lievemente palesandole… Una visita d’addio. Scendemmo dalla macchina...Volevo anzi chiudermi stretta stretta in me, raccogliere tutte le impressioni, tutti gli odori, tutti i frammenti di paesaggio che avrei potuto portare nel mio petto troppo piccolo per contenerli tutti. La terra si era fatta scura, i marmi slavati avevano assunto un pallore lunare, il silenzio ritmato dalle folate di vento dava alla città un’identità nuova in cui nemmeno le anime stesse tacite abitatrici dei luoghi, si riconoscevano. Non le sentivo più vagare intorno a me, in cerca di chissà quale consolazione. Forse si nascondevano in attesa di vedere sorgere nuovi mondi. Forse qualche arcano filo si era spezzato in me e mi ritrovavo inconsapevole orfana dell’anima stessa del mondo, il cui alito avevo finora percepito con tale noncurante naturalezza. Affrettai il passo verso lo zio. Thuburbo Majus non mi interessava più.”
[6] R. di Stefano, A flanc de Bou-Kornine, Ragusa, Ed. Criscione Technoplast Graficarta, 1985.
[7] G. Dugas, op.cit. in Littératures des Immigrations sous la direction de Charles Bonn, L’Harmattan, 1995, p. 163.
[8] M. Pendola, op.cit. p.15-16 : « Ma Alî che era stato fino a pochi mesi prima seduto dietro di me nella scuolettina di Draa-Ben-Jouder, ora fingeva di non riconoscermi, anzi, mi trattava come un’estranea, come una nemica da controllare. Dopo quell’incontro cominciai a capire che il mondo intorno a me era cambiato in modo definitivo. E pian piano mi arresi all’evidenza : ero diventata straniera nel mio stesso paese. Questo paese nel quale ero nata, di cui avevo respirato fino all’ebrezza l’alito odoroso di mirto, che avevo calpestato a piedi nudi nei caldi pomeriggi d’estate saltellando qua e là come una capretta, questo paese non mi apparteneva più.. »
[9] L. Sitruk , La Condition des Italiens en Tunis, Tunis, Imprimerie du Journal «la Presse », 1947. p.115 - 120.
[10] Id. : p.121
[11] R. Zaouchi-Razgallah, L’apport toscan en Tunisie de 1830 à 1945, approches littéraires in Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du protectorat, Colloques internationaux, Université Tunis I –ISHMN, Tunis, 2000, p.131-167.
[12] G. Dugas, op. cit., p. 92
[13] G. Héraud, op. cit., p. 28.
* Il s'agit de Pascal di Stefano (père de l'écrivain Rosaire di Stefano), qui a été champion de Tunisie de cyclisme en 1931.
** "Le palmier' et "La citeria" se trouvaient à Tunis, la capitale.
*** " L'on avait coutume d'appeler les juifs d'origines diverses : juif italien, juif
espagnol, juif portuguais, juif tunisien....
**** En réalité de très modestes ouvriers.


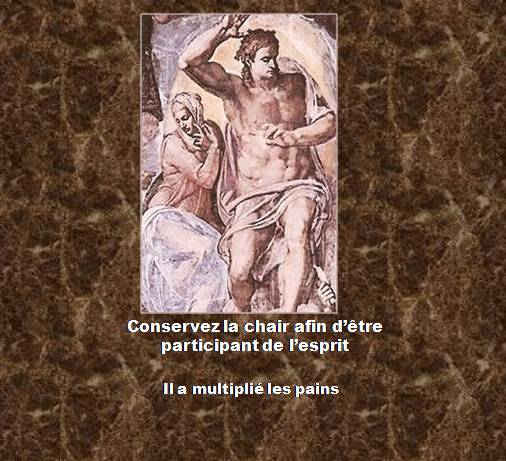
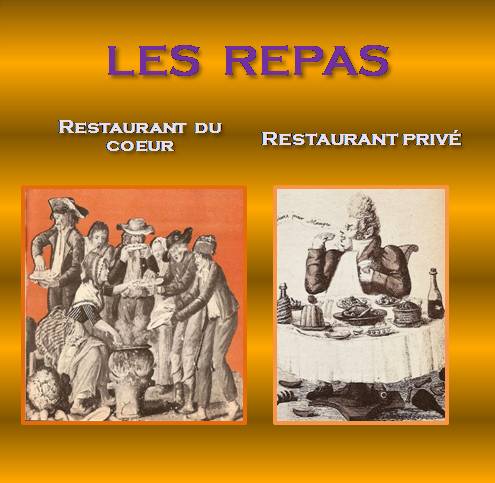
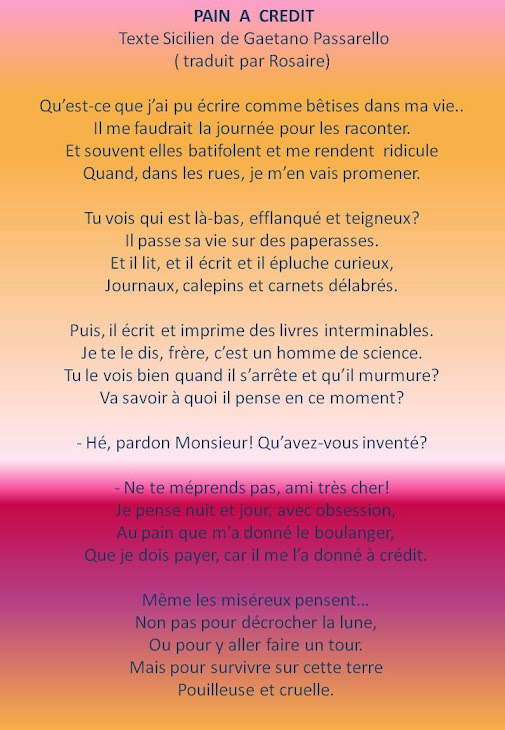






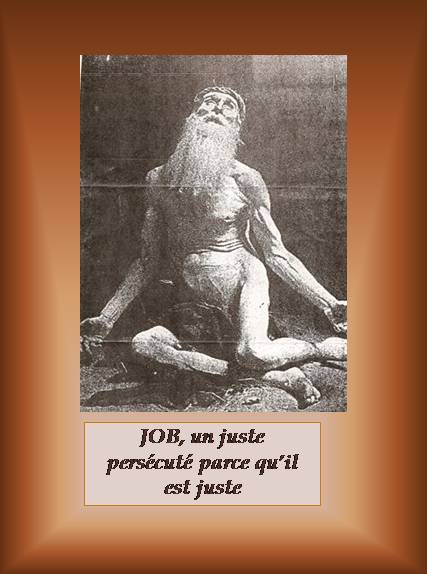


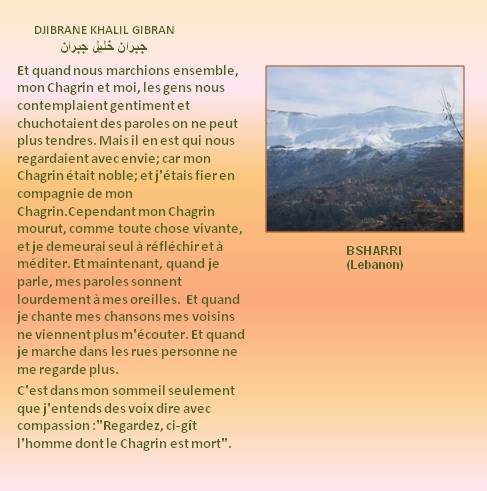








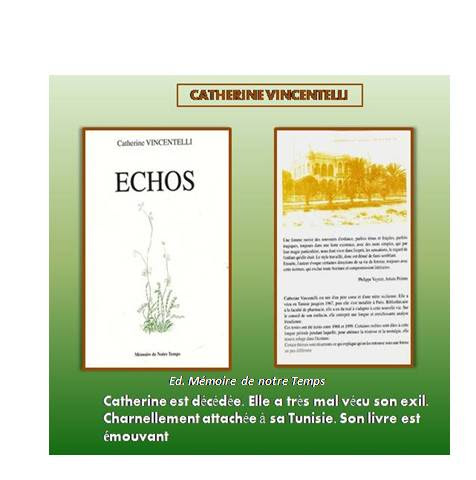


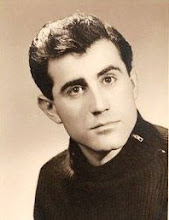









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire